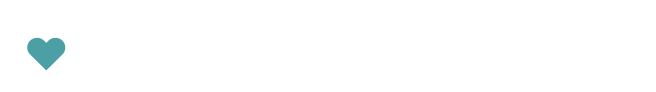Coopératives
ou organisations
à but non lucratif
(OBNL)
L’habitation de nos aînés, qui est au cœur des discussions depuis plusieurs années, est un sujet de réflexion généralisé dans la société québécoise. Ce projet d’habitation communautaire pour aînés, qui a pris fin en juin 2022, avait justement pour objectif de faire connaître et de développer un modèle à but non lucratif qui permettrait de faire en sorte que les aînés aient plus de choix quand vient le moment de quitter leur domicile.
Amorcé en mars 2020, ce projet avait pour visée de faire connaître le modèle d’habitation communautaire pour aînés et de renforcer le pouvoir d’agir des citoyens et des organismes du milieu intéressés à se lancer dans la création d’un milieu de vie.
Malgré le ralentissement et les nombreux défis relatifs aux restrictions sanitaires liés à la pandémie de la Covid-19, nous sommes parvenus à faire connaître le projet à près de 2 000 personnes, que ce soit lors de séances d’information offertes dans les 9 MRC de l’Estrie ou lors de présentation dans différents événements. Nous avons également eu le plaisir d’accompagner six groupes de citoyens dans les premières étapes du développement d’un projet d’habitation communautaire pour aînés.
Bien que le projet soit maintenant terminé, depuis juin 2022, nos outils d’aide à la décision ainsi que les documents de référence que vous retrouverez sur ce site internet sont maintenus en ligne pour vous soutenir et vous guider.

Si vous êtes un nouveau groupe en Estrie, qui souhaitez développer une habitation communautaire pour aînés, nous continuons d’offrir l’animation d’ateliers de façon ponctuelle, sous réserve de la disponibilités des ressources.
Écrivez-vous pour plus d’informations à bonjour@oedc.qc.ca.
Bâtir un projet

Contexte social
Depuis une vingtaine d’années, on remarque une tendance à l’uniformisation de l’offre en habitation pour aînés au Québec, et ce, sur deux plans. D’une part, la très vaste majorité des ressources d’habitation pour aînés certifiées par le Ministère de la Santé et des Services sociaux sont de propriété privée à but lucratif. D’autre part, le nombre de grandes résidences privées pour aînés (RPA) a augmenté alors que le nombre de RPA de petite taille a diminué de moitié entre 1994 et 2014. Si la formule RPA privée de grande taille peut convenir à certains, elle ne répond pas aux besoins et aux préférences de tous, sans compter qu’elle ne peut s’établir sur les territoires à faible densité démographique, comme en milieu rural.
Au plan social, les grandes RPA ont pris une place importante au Québec. Cependant, les conditions financières d’une proportion importante d’aînés ne leur permettent pas d’y vivre jusqu’à leur décès, d’autant plus que les revenus s’amenuisent avec l’avancée en âge. L’accessibilité financière d’une habitation et la possibilité de vivre dans un même milieu sans être contraint d’en changer à cause d’une santé vacillante constituent un objectif atteignable par les habitations communautaires.
Avec les questionnements soulevés par la crise de la COVID-19 et dans un contexte où les aînés affirment leur préférence pour vieillir chez soi, une révision de la diversité de l’offre d’habitations accessibles et abordables aux aînés s’impose.

Historique
En 2017, l’Observatoire estrien du développement des communautés (OEDC), grâce à la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA), a réalisé une étude d’impact social et économique sur 3 habitations communautaires pour aînés et a adapté plusieurs outils d’un chercheur belge sur la question. Le projet était co-dirigé par l’OEDC (Nelson Gendron, directeur général) et le Centre de recherche sur le vieillissement (Suzanne Garon, chercheure responsable de l’Équipe MADA). Le projet n’aurait pas été réalisé sans l’apport du comité de coordination (Mario Paris, professeur à l’Université de Moncton et Lynda Binhas, ressource externe de l’OEDC), du comité de pilotage (Marie Toupin de l’AQDR, Johanne Sanschagrin de la CSHL, Isabelle Huet du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Sylvie Hinse de la Coopérative de solidarité Oasis des Lacs et Serge Vaillancourt du GRT Entraide Habitat Estrie).
Cela a résulté, en fin de projet, par la création du Guide HABA-ISAD, un guide qui vise à aider les groupes d’aînés promoteurs dans leurs démarches en leur proposant une panoplie d’outils d’aide à la décision et de pistes de réflexions.
En 2019, souhaitant faire connaître ce modèle au plus grand nombre et ainsi stimuler l’émergence de nouveaux lieux de vie pour les aînés estriens, l’OEDC a obtenu un nouveau support du Secrétariat aux aînés, via le programme QADA, pour lancer son initiative de diffusion : Projets collectifs d’habitations pour aînés qui vise à faire connaître et rayonner ce modèle.
Ainsi, entre 2020 et 2022, l’OEDC a mis son expertise en soutien au service des citoyens de l’Estrie qui souhaitent passer à l’action pour réaliser un projet d’habitation dans leur milieu, en complémentarité avec les ressources déjà existantes), afin de les accompagner dans la concrétisation de leur dessein.
Les avantages
Documents de référence
Le rapport
Mesure d’impact social et économique
Le guide
pour citoyens promoteurs
Le cahier
des fiches descriptives
Le kit
d’animation